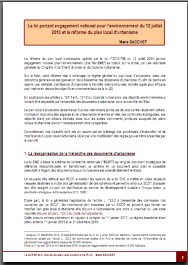Dans une décision rendue le 13 décembre 2013, le Conseil d’Etat confirme la jurisprudence Quenesson en matière de travaux portant sur un mur mitoyen, en abandonnant ainsi définitivement la théorie du propriétaire apparent.
Antérieurement à cet arrêt, le Conseil d’Etat considérait que le régime juridique de la mitoyenneté (établissant une présomption de propriété commune) faisait obstacle à ce qu’un des copropriétaires d’un mur mitoyen puisse être considéré comme le propriétaire apparent dudit mur et puisse en conséquence solliciter seul une autorisation sur ledit mur.
Il convenait en conséquence qu’il puisse justifier de l’accord des autres propriétaires du mur et il appartenait à l’administration d’exiger la production du consentement des autres copropriétaires du mur, à l’appui de toute demande d’autorisation portant sur des travaux entrant dans le champ d’application de l’article 662 du Code civil (appui ou enfoncement sur le mur mitoyen).
Dans cet arrêt du 13 décembre 2013, le Conseil d’Etat rappelle qu’il n’appartient pas au juge administratif d’assurer le respect de droits de nature privée et qu’il appartient aux copropriétaires du mur mitoyen de contester devant le juge judiciaire les travaux réalisés sur le mur mitoyen sans leur autorisation.
L’autorité administrative, pour sa part, se contente de vérifier le respect des dispositions prévues par les articles R. 431-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Elle ne saurait inférer dans la gestion de droits de nature exclusivement privée.
L’article R. 431-5 du Code de l’urbanisme exige que l’administration vérifie que la demande de permis comporte « l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ». Or, s’agissant de travaux portant sur un bien indivis, l’article R. 423-1 du Code de l’urbanisme exige simplement que la demande de permis soit présentée « en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ».
L’article R. 423-1 du Code de l’urbanisme autorisant un indivisaire à déposer seul une demande de permis de construire, l’autorité administrative n’a pas à vérifier qu’il a obtenu l’accord des autres coindivisaires. C’est ce que rappelle expressément le Conseil d’Etat dans cet arrêt du 13 décembre 2013 :
« 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a acquis le 18 juillet 2007 un édifice sis 47, cours Napoléon à Ajaccio, en arrière-cour d'un immeuble sur rue placé sous le régime de la copropriété ; qu'il a déposé le 6 mars 2008 une demande de permis de construire pour la réalisation de travaux portant sur la toiture et la façade de l'édifice et la création d'environ 14 m² de surface hors œuvre nette ; que le maire d'Ajaccio a accordé le permis sollicité par arrêté du 2 avril 2008 ; que, par un jugement du 16 avril 2009, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de ce permis ; que, par un arrêt du 24 novembre 2011, contre lequel M. B...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement et le permis de construire contesté ; que, pour annuler le permis litigieux, la cour, faisant application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, a retenu […] que ce permis avait été délivré sans l'accord de la copropriété, requis en raison de la présence d'un mur mitoyen […] ;
2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, applicable aux demandes de permis déposées à compter du 1er octobre 2007 : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés: / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; (...) " ; que le dernier alinéa de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dispose : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'en vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33 ; que l'article R. 423-38 du même code dispose que l'autorité compétente réclame à l'auteur de la demande les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l'article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé, dans tous les cas, comme ayant qualité pour présenter cette demande ;
3. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 653 du code civil établissent une présomption légale de copropriété des murs séparatifs de propriété ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées au point 2, notamment du b) de l'article R. 423-1, qu'une demande de permis de construire concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant qu'il appartenait à l'autorité administrative compétente, saisie d'une demande de permis de construire prévoyant des travaux portant sur un mur séparatif de propriété, d'exiger du pétitionnaire, outre l'attestation mentionnée au point 2, la production d'un document établissant soit que M. B...était seul propriétaire de ce mur, soit qu'il avait l'accord de l'autre copropriétaire de ce mur, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; »